Les vêtements de plein air sont souvent très nocifs pour l’environnement, malgré certaines visées d’écoresponsabilité mises de l’avant par l’industrie. La mode gorpcore peut toutefois inciter ses adeptes à se tourner vers des vêtements durables, résistants tant aux intempéries qu’aux tendances capricieuses de la mode jetable.
Les manteaux Kanuk faisaient rage, les La Cordée faisaient fortune, « c’était l’époque du Bernard Voyer », se remémore Jocelyn Bellemare, chargé de cours à l’École supérieure de mode de l’UQAM. Bien avant qu’elle soit baptisée gorpcore, la tendance au suréquipement de vêtements de plein air chez les citadin(e)s avait aussi, il y a près de 40 ans, touché sa génération.
Le terme tire son origine de l’expression « good old raisins and peanuts ». C’est le fameux trail mix dégusté par les randonneurs et randonneuses en quête de connexion avec la nature.
M. Bellemare explique que le gorpcore valorise un mode de vie plus actif. « Lorsqu’on a des chaussures de promenade, qu’on a des vêtements pour l’extérieur, qu’on est bien équipé, on aime ça, on se sent vivant. Je pense que c’est ce que cette communauté veut, se sentir saine et vivante », explique-t-il.
Une industrie polluante
Un vêtement de sport est, en moyenne, composé à 90 % de matières pétrochimiques, comme le polyester, le nylon ou l’acrylique, selon la Fondation Terre Solidaire. C’est sans compter les teintures et les enduits chimiques utilisés pour imperméabiliser ou lubrifier les vêtements techniques, tels que les SPFA, les tristement célèbres « produits chimiques éternels ». De plus, les teintures et autres produits de finition, grâce auxquels les imperméables sont si étanches et si pimpants, sont responsables d’environ 20 % de la pollution mondiale de l’eau, estime Environnement et Changement climatique Canada.
« Les fils synthétiques – tout ce qui est nylon, Gore-Tex, polyester– ce sont des microplastiques, explique M. Bellemare. Ça va dans nos eaux, même l’eau potable, et c’est très difficile à détecter. »
Le plus problématique ? Le contact de ces matériaux avec la peau, surtout lorsque le corps bouge et transpire et que les pores sont dilatés.
Produire autrement
La fondatrice et présidente de la marque québécoise de vêtements plein air Bonnetier, Isabelle Marcotte, affirme que le public est de plus en plus sensibilisé aux répercussions des fibres synthétiques. « On voit une certaine clientèle, par exemple des coureurs, qui auraient porté des vêtements synthétiques de la tête aux pieds, se tourner vers des matières plus naturelles, comme la laine mérinos », observe-t-elle. Elle insiste toutefois sur le fait que cette conscientisation ne s’étend pas à l’échelle de « monsieur et madame Tout-le-Monde ».
Sur le site de Bonnetier, un chandail pour femme fabriqué à 96 % de laine de mérinos, conçu pour garder au chaud lors d’activités hivernales, coûte 130 $. Sur le site d’un détaillant de vêtements de plein air, un chandail du même type, mais composé à 100 % de polyester, revient à seulement 10 $.
Cheffe d’entreprise depuis 2013, Mme Marcotte estime que la transition vers la production de vêtements techniques écoresponsables est impossible si l’intérêt du public n’est pas au rendez-vous. Même si une compagnie utilise des matières écologiques dans la mesure du possible, il lui est coûteux de tenter de réutiliser ses surplus de matières, ses « déchets ».
« Ça prend des défibreuses, des équipements spécialisés, puis ça ne court pas les rues, c’est complexe, souligne la présidente de Bonnetier. On n’a pas encore l’écosystème en place pour rendre ça accessible aux entreprises. »
Consommation éthique
C’est en travaillant au Sports Experts que Markhly Delva, un étudiant à la maîtrise en architecture à l’Université de Montréal, a commencé l’élaboration de sa garde-robe extérieure. Il sortait alors des cadets et avait un intérêt marqué pour le plein air, mais aucun équipement à lui pour le prouver. Entouré « de Salomon, de Gore-Tex et de Vibram » ainsi que d’expert(e)s sur le sujet, il s’est peu à peu approprié cet univers.
Vêtu d’un imperméable noir Arc’teryx en Gore-Tex et de chaussures Salomon blanches immaculées, le jeune homme avoue ne pas faire « des [randonnées] dans les Laurentides à chaque jour ». Tout de même, investir dans des vêtements techniques de qualité l’a conscientisé par rapport à ses dépenses.
« Acheter un produit qui coûte 300 $, c’est vraiment intimidant et ça semble [insensé]. Mais quand tu te dis que tu ne vas pas racheter un autre produit comme ça dans les 15 prochaines années, ça justifie l’achat », explique-t-il.
Outre le fait de choisir ses investissements avec méticulosité, l’étudiant prend soin de ses achats pour assurer leur durabilité. Lorsqu’ils se brisent, il les répare ; lorsqu’il se lasse d’un morceau, un(e) ami(e) est toujours disposé(e) à faire du troc.
Économie circulaire
Cette perspective, inspirée de l’économie circulaire, engendre, sur une plus grande échelle, la création de programmes de seconde main, tels que ReGear d’Arc’teryx ou Worn Wear de Patagonia. Ces plateformes permettent à la clientèle de revendre ou d’acheter des produits usagés à prix réduit.
Ces pratiques, qui n’étaient pas courantes dans les années 1980, indiquent, selon le chargé de cours Jocelyn Bellemare, une conscience environnementale accrue chez la Génération Z. « Le jeune qui a 19 ou 20 ans, qui n’a pas d’argent, mais qui va s’acheter un produit au look technique, gorp, c’est déjà quand même un premier pas, s’il est pour garder son vêtement longtemps », estime M. Bellemare.
En développant un style de vie et des habitudes de consommation écoresponsables, les entreprises suivront la demande et développeront des mécanismes de production axés sur la durabilité et l’écologie, selon le chargé de cours. « Si Patagonia est devenue ce qu’elle est, ce n’est pas pour rien, remarque-t-il. C’est qu’elle avait une niche de gens avec une philosophie. »


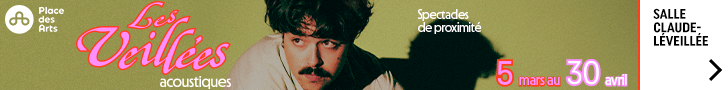
Laisser un commentaire