Depuis plus de 30 ans, le VIH/sida fait des ravages sur l’ensemble de la planète. Lors de la dernière Journée mondiale de lutte contre le sida, l’Organisation des Nations unies (ONU) relevait dans un rapport que le nombre de personnes infectées par le VIH avoisinait les 37 millions en 2014. Toutefois, les gouvernements en place ont des défis à relever. Les traitements ne sont pas toujours accessibles à tous et il faudrait toujours plus de prévention.
Le 5 juin 1981 apparaissaient les premiers cas de personnes infectées par le VIH. Aujourd’hui, la maladie plane toujours et les chercheurs tentent d’anéantir le virus et sa propagation. Le 1er décembre dernier, lors de la Journée mondiale du sida, plusieurs chercheurs, dont Cécile Tremblay, du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM), ont affirmé que le Québec pourrait éradiquer le VIH et sa transmission en cinq ans. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) soutient pour sa part qu’il est possible d’éliminer le virus sur la planète d’ici 2030.
L’objectif fait rêver. Malgré les énormes progrès qui ont été réalisés au sein des diverses équipes de recherche, certains spécialistes soutiennent que la suppression de la propagation du VIH d’ici cinq ans n’est peut-être pas aussi facile qu’on ne le croit. «Je pense que ça prend une volonté politique beaucoup plus importante que ce qu’on a actuellement, soutient la professeure au Département de sexologie de l’UQAM, Joanne Otis. Il faudrait qu’il y ait un plan d’action. Nous avons besoin d’une politique de lutte contre le VIH qui est beaucoup plus agressive et beaucoup plus articulée.»
Selon la professeure, les ressources et l’argent investi diffèrent d’un groupe à l’autre, ce qui crée des iniquités. Elle soutient l’importance de viser les populations clés. «Ce ne sont pas les mêmes ressources, par exemple, qui sont allouées aux hommes gais et aux utilisateurs de drogue par injection, envers lesquels des efforts incommensurables et de l’argent ont été davantage octroyés par le gouvernement.»
Joanne Otis affirme que toute personne infectée devrait recevoir un éventail de services interdépendants, qui permettraient de répondre à différents besoin. «Au sein des services de santé, il faudrait qu’il y ait une approche un peu plus “holistique” de la santé, plutôt qu’une approche par silos, compartimentée par problématiques.» Par exemple, une personne qui pense être infectée devrait pouvoir avoir accès, au même endroit, autant à un service de dépistage qu’au soutien d’un psychologue.
De l’avant avec le Truvada
Le 29 février, une bonne nouvelle a été annoncée quant à la prévention du VIH: Santé Canada a approuvé le Truvada. Les personnes séronégatives peuvent désormais se faire prescrire ce médicament comme une prophylaxie pré-exposition (PrEP). Ainsi, les personnes qui ont des comportements sexuels à risque peuvent se protéger davantage et éviter de contracter le virus. «Avant, on ne donnait du Truvada qu’aux personnes séropositives, afin que leur charge virale soit indétectable et qu’elles ne puissent pas transmettre le virus à d’autres personnes», rappelle Joanne Otis.
Il y a des défis à relever quant à l’accessibilité du Truvada. «La PrEP, ça coûte une fortune. Au Québec, heureusement, on a l’assurance médicament. Mais dans d’autres provinces, dans d’autres pays, est-ce que les gens ont les moyens de payer 900$ par mois pour prendre un médicament préventif ? L’annonce de Santé Canada va toutefois pousser les provinces à se donner des lignes directrices pour rendre accessible la PrEP», croit Joanne Otis. Notons qu’un patient qui consomme le Truvada et qui n’a aucune assurance peut payer de 907 à 995 $ par mois, selon l’organisme communautaire montréalais Rézo. La facture peut donc s’élever à 11 940$ par année.
Éducation et sexologues s’il vous plaît!
Depuis septembre, un projet pilote du ministère de l’Éducation pour le retour des cours d’éducation sexuelle obligatoires dans les écoles primaires et secondaires a été mis en place dans 19 établissements du Québec. Joanne Otis explique la pertinence du sexologue dans la mise en place de ces cours. «Le duo sexologue-enseignant serait très bien. Le sexologue dans l’école peut jouer un rôle d’accompagnement de plusieurs enseignants, mais peut aussi jouer un rôle dans l’organisation des activités hors classe, comme l’or ganisation de la semaine de lutte contre l’homophobie», avance la professeure.
Dans les cours d’éducation sexuelle, le VIH doit évidemment être décortiqué, en plus des différents aspects de la sexualité et de la santé sexuelle en général. «Pour un jeune, ce n’est pas nécessaire qu’il y ait 40 heures par année de cours d’éducation sexuelle, pense Joanne Otis. L’important, c’est la continuité. Au fil de son développement, il suffit qu’à chaque année une porte s’ouvre; il faut qu’il y ait un espace où le jeune puisse identifier les personnes clés dans son école pour parler de sexualité.» Joanne Otis souligne que de l’éducation sexuelle doit se faire à l’école, mais doit aussi être complétée par les différents acteurs du milieu qui entoure l’enfant, dont les parents.
Encore à ce jour, le VIH ne se guérit pas, mais une personne infectée a la possibilité d’avoir la même espérance de vie qu’une personne qui est séronégative. Le 25e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/SIDA aura lieu du 12 au 15 mai 2016 à Winnipeg. Selon Joanne Otis, la récente approbation du Truvada par Santé Canada et les enjeux entourant la PrEP seront sur toutes les lèvres.
Photo: Andy McCarthy | via Flickr

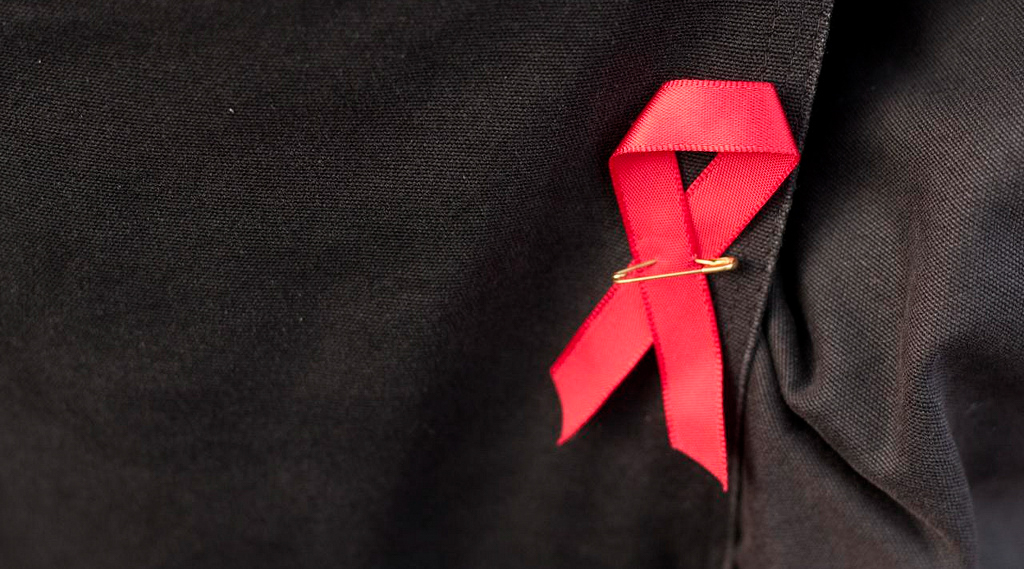

Laisser un commentaire