Entre des rideaux d’épiderme et un bal de robes coloniales, l’exposition Éloges de l’image manquante éclaircit de bien sombres destins. Les artistes Caroline Mauxion, Raphaël Barontini et Gabrielle Goliath y exposent chacun(e) une nouvelle lecture de l’histoire à la Galerie d’art de l’UQAM jusqu’au 25 octobre.
L’exposition est présentée dans le cadre de MOMENTA, un événement d’art contemporain ayant lieu tous les deux ans à Montréal. La Galerie d’art de l’UQAM est l’un des onze lieux d’exposition de la métropole. « On s’assure d’avoir un panel d’œuvres et d’artistes très diversifiés et on est très connecté avec ce que les gens pensent », insiste Dominique Sirois-Rouleau, directrice générale de MOMENTA et ancienne chargée de cours d’histoire de l’art à l’UQAM.
L’arrimage entre les lieux d’exposition et les artistes n’est pas fait au hasard, assure-t-elle. Mme Sirois-Rouleau explique que les exposant(e)s ont notamment été choisi(e)s pour refléter les préoccupations des universitaires comme la santé mentale et les inégalités sociales.
Toucher des corps sensibles
L’installation À la croisée du soin et du désir, qui accueille les visiteurs et visiteuses de la galerie, s’inspire du vécu de Caroline Mauxion, artiste émergente et doctorante en études et pratiques des arts de l’UQAM.
Les archives médicales de l’artiste tapissent certaines œuvres. « Je réfléchis aux dispositifs mis en place pour redresser puis normaliser les corps. Ces appareillages, ces tiges de métal, ces corsets en sont des métaphores », indique-t-elle.
Les photos de corps dénudés en noir et blanc négatifs prises par l’artiste sont « une façon d’entremêler le parcours médical avec la notion de désir charnel et ainsi de se réapproprier son corps », explique Mme Mauxion. Le désir est exprimé à travers « ces corps médicalisés, qui ont beaucoup été touchés, manipulés, regardés différemment », estime-t-elle.

La multitude de matériaux utilisés par l’artiste rappelle les différentes textures de la peau. « On regarde avec le corps et plus seulement avec les yeux. On doit aussi se déplacer, on a presque envie de les toucher », dit-elle au sujet de ses œuvres.
Elles sont mises en lumière dans la thèse doctorale de l’artiste, dont les recherches portent sur les sujets queer et crip. Crippled est un terme péjoratif pour désigner les personnes en situation de handicap que cette communauté s’est réapproprié.
Ces thématiques résonnent chez certain(e)s visiteurs et visiteuses. « J’ai moi-même des malformations du pied. Les rideaux comme dans une chambre d’hôpital, ça m’a vraiment touchée », affirme Noémie Bach, étudiante en arts visuels à l’UQAM.
Rapiécer l’histoire
Avec son œuvre Twòn Kreyol, l’artiste Raphaël Barontini donne vie à des portraits, des costumes et des fresques inspirés des parades carnavalesques et des rites de résistance en mémoire des luttes contre l’esclavage.
Par le collage et le montage, l’artiste français propose une expérience visuelle audacieuse, mêlant iconographie classique et photographies ethnographiques coloniales issues d’Afrique de l’Ouest.

Barontini met en lumière des figures militaires s’étant affranchi de l’esclavage comme Toussaint Louverture et Dutty Boukman tout en interrogeant les mécanismes de leur effacement dans l’histoire officielle. Les archives photographiques deviennent des hommages visuels qui transforment l’art en acte de réappropriation culturelle et de réparation symbolique.
Berceuse brutale

L’installation vidéo et sonore de l’artiste sud-africaine Gabrielle Goliath, Élégie – pour deux ancêtres, projette tour à tour sept chanteuses d’opéra qui maintiennent la même note pendant une heure complète. L’’œuvre a été créée à la mémoire des femmes et des personnes LGBTQ+ victimes de violences patriarcales.
Ces chants à relai se muent, dans la noirceur, en acte politique : une commémoration intime, où l’art devient un cri contre l’oubli et un hommage à ceux et celles que la société a trop souvent réduit(e)s au silence.


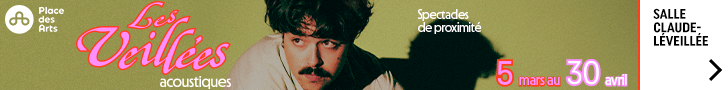
Laisser un commentaire