Partiellement arrachées par le temps et les intempéries, les affiches de rues montréalaises cèdent leur place à une nouvelle ère de publicité urbaine. Derrière cette mutation, le numérique, les réglementations et les monopoles redéfinissent la pratique.
Au tournant des années 2000, la Ville de Montréal s’est mise à appliquer des contraventions à l’endroit de certain(e)s membres de la communauté d’affichage sauvage. Par sauvage, on entend une publicité affichée sans permission préalable. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que se forment des groupes mobilisés contre l’application de directives considérées comme dommageables à la liberté d’expression par certain(e)s. En réponse, la Ville a mis en place des zones d’autopublicités légales et encadrées qui prennent la forme de babillards extérieurs entretenus par la Ville où quiconque peut afficher gratuitement.
En avance sur les changements de réglementation, Baudoin Wart, le fondateur de Publicité Sauvage, scelle des partenariats avec le milieu privé. Dès lors, son entreprise n’affiche que sur les palissades de chantiers de construction et à l’intérieur de quelques commerces urbains. « On est probablement le seul réseau sauvage avec des ententes signées pour que [chaque client] ait des redevances », se satisfait-il.
Selon Marc H. Choko, professeur émérite à l’École de design de l’UQAM, « Publicité Sauvage n’a plus rien de sauvage depuis très longtemps ». L’entreprise s’est éloignée de l’héritage qui lui vaut son nom pour s’imposer dans le domaine publicitaire, d’après M. Choko.
« Publicité sauvage n’a plus rien de sauvage depuis très longtemps »
– Marc H. Choko, professeur émérite à l’École de design de l’UQAM
Baudoin Wart souligne que sa compagnie peut généralement retirer en moins de 24 heures toute affiche superposée sur celle d’un(e) client(e). Quelque 125 palissades sont aujourd’hui inscrites au réseau publicitaire transcanadien de Publicité Sauvage.
Selon M. Choko, il serait difficile d’imaginer qu’une autre agence d’affichage puisse s’imposer avec une offre rivalisant celle de Publicité Sauvage. « [L’agence est] là depuis tellement longtemps qu’il est sûr que c’est elle qui ont un avantage pour le démarchage des entrepreneurs. »
Ce dernier estime le coût pour les client(e)s des services publicitaires entre « 1500 à 2000 $ au minimum ». M. Choko considère improbable qu’un plus petit(e) annonceur ou annonceuse puisse se permettre de payer pour une affiche publicitaire signée Publicité Sauvage.
Le prix de la visibilité
Nouvellement responsable à la mobilisation pour le Mouvement étudiant indépendantiste (MEI), Alexis Gagnon mène plusieurs campagnes d’affichage sauvage. Il valorise ce modèle publicitaire pour les faibles coûts impliqués, reprochant du revers le manque de zones d’affichage légales.
Sur ces quelques points de diffusion, il participe à une compétition constante avec de plus petites agences d’affichage. « Tu te fais rapidement couvrir d’affiches de spectacles d’autres organisations qui paient des gens pour afficher. On est des étudiants qui font ça à temps partiel », se désole-t-il.
Animé par le désir de marquer le paysage urbain, il s’est résigné à mener une campagne d’affichage qui déborde des zones autorisées. Pour mettre son organisation de l’avant, propriétés publiques, infrastructures et boîtes aux lettres lui sont serviables.
Publiant ces campagnes risquées sur le compte Instagram du MEI, il présente la publicité numérique comme une simple option à faible gain. Sur cette plateforme, il a à compétitionner pour l’attention éphémère des utilisateurs et utilisatrices. Le responsable à la mobilisation du MEI critique aussi la surcharge informationnelle en ligne qui « rend difficile d’avoir une visibilité ».
Une lutte à coups de coms
Partis d’un mouvement rebelle en marge de la commercialisation massive, Publicité Sauvage est désormais munie d’une stratégie marketing grand public. Selon Flavie Spérano, étudiante en communication à l’UQAM, les affiches des plus petites organisations « manquent » de stratégie marketing. « Je trouve que ça a l’air d’être un peu botché [bâclé] », se plaint-elle. Étant plus alerte aux annonces travaillées de la compagnie de Baudoin Wart, elle s’avoue rarement interpellée par celles qu’elle croise dans les corridors de l’UQAM. « Ça manque d’interactivité et de couleurs », juge-t-elle.
Si les antipodes se réservent quelques critiques mutuelles, tous et toutes se mettent d’accord sur une idée : l’affichage de rue n’est pas près de disparaître.


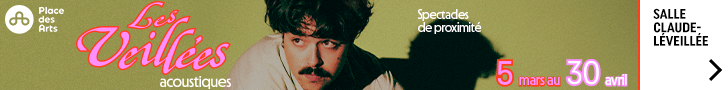
Laisser un commentaire